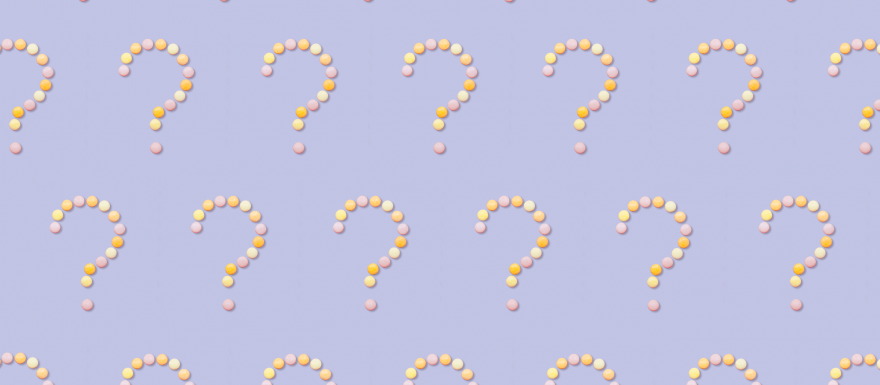L'allergie résulte d'une perte de tolérance immunitaire à des substances, a priori inoffensives, rencontrées dans la vie quotidienne (les « allergènes », par exemple les pollens, les poils, les moisissures, des aliments, le nickel, le latex, etc.). Une fois qu'elle est devenue sensible à un allergène, la personne allergique présente, à chaque nouveau contact, une réaction immunitaire inadaptée : lorsque l’allergène entre en contact avec des cellules des muqueuses ou de la peau, certaines cellules voisines libèrent dans le sang de l’histamine, un composé qui provoque les manifestations de l’allergie (rougeur, irritation, éternuements, eczéma, etc.).
Le nombre de personnes allergiques est en augmentation constante en France : entre 25 et 30 % de la population en souffriraient. Les allergies ont souvent une origine génétique familiale (on parle de « terrain allergique » ou « atopie ») mais d’autres facteurs peuvent favoriser son apparition : alimentation et conditions de vie pendant la petite enfance, pollution (ozone et petites particules liées au diesel), usage professionnel de matières allergisantes, etc.
Plusieurs études suggèrent une moindre fréquence des maladies allergiques chez les sujets qui ont présenté des infections respiratoires répétées au cours de leurs premières années de la vie. Ainsi, en prévenant ces infections de la petite enfance, l’amélioration régulière des conditions d’hygiène pourrait contribuer à l’augmentation de fréquence des maladies allergiques. Mais cela n’est pas encore prouvé de manière certaine.
Il n’existe aucune évidence scientifique concernant une possible origine psychologique des allergies. Certains spécialistes ont suspecté que le stress chronique pourrait aggraver les symptômes d’une allergie préexistante, comme cela semble être le cas pour l’asthme. Néanmoins, pour l’instant, aucune étude sérieuse n’est venue confirmer cette hypothèse, hors cas particulier de l’asthme.
Sources
Allergies, Assurance maladie, 2022
Allergies, INSERM, 2017